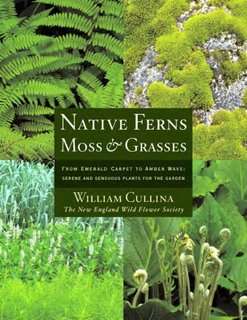L ‘apogamie, reproduction asexuée
4 décembre 2008En vue d’expliquer ce phénomène curieux qu’est l’apogamie, il est nécessaire de revenir sur le cycle de reproduction des fougères.
Ce cycle consiste en deux phases alternées ou deux générations, chacune de ces deux générations débutant à partir d’une seule cellule :
Le sporophyte, issu d’un zygote ( oeuf fécondé ) , est la fougère que nous connaissons qui produit les spores, d’où son nom. C’est la génération asexuée car elle ne porte pas d’organes sexuels.
Le gamétophyte, issu d’une spore, est le prothalle , ainsi nommé car il produit les cellules sexuelles, les gamètes. C’est la génération sexuée.
Les gènes qui déterminent les caractéristiques individuelles d’un organisme sont transmis par les chromosomes, dans le noyau des cellules.
Tout commence donc à la formation des spores.
Dans le sporange en formation, la cellule centrale se divise pour former 2 cellules qui à leur tour se divisent pour former deux cellules chacune, et ainsi de suite jusqu’à un total de 16 cellules issues de la cellule originelle. Finalement ces 16 cellules mères de spores se divisent pour former 4 cellules filles chacune, ce qui donne un total de 64 spores par sporange. Ce processus est connu sous le nom de méiose. Pendant la méiose, les cellules mères des spores reproduisent leurs chromosomes 1 fois, mais les divisent 2 fois. Par conséquent la spore possède seulement la moitié du nombre de chromosomes de la plante mère, soit 1 lot simple. On dit qu’elle est haploïde, tandis que la plante mère qui possède le double de chromosomes, soit 2 lots, est dite diploïde.
Les spores sont libérées des sporanges, et si tout se passe bien, se déposent sur un terrain accueillant où elles germent. Elles se développent et donnent le prothalle qui est la génération gamétophyte, ainsi nommée parce qu’elle possède les organes sexuels et produit les gamètes. Ces organes sexuels, mâles et femelles, appelés anthéridies et archégones, produisent respectivement le sperme et les ovules. Ils sont disposés sous la face inférieure du prothalle. Quand une fine pellicule d’eau est présente, les anthéridies s’ouvrent et lâchent les anthérozoïdes qui ont une forme spiralée et sont équipés de longues flagelles leur permettant de nager rapidement vers les archégones. Chaque archégone contient un seul oeuf, et lorsque celui ci est arrivé à maturité et qu’il est prêt à être fécondé, l’archégone s’ouvre afin de laisser pénétrer les anthérozoïdes. L’oeuf fécondé donne naissance à une nouvelle plante, le sporophyte, qui à sont tour produira des spores pour perpétuer le cycle de la vie.
Parce que un gamète mâle haploïde et un gamète femelle haploïde donnent un zygote diploïde, la condition diploïde, qui est la condition originelle de la plante qui a produit les spores, le sporophyte, s’en trouve rétablie.
Le cycle de reproduction apogame diffère de ce schéma reproductif sexué parce qu’il se déroule sans fusion des gamètes. Mais comment cela est-il possible ?
Au lieu de produire 64 spores haploïdes par sporange, comme nous l’avons vus précédemment, les fougères apogames, à la faveur d’un accident génétique, produisent 32 spores diploïdes, possédant donc déjà les deux lots chromosomiques de la plante mère. Lorsque la spore germe, elle se développe en un prothalle plus petit que celui des espèces non apogames. Les organes sexuels, s’ils sont présents, ne sont pas fonctionnels, et une minuscule plante possédant racine, tige et feuille, se développe sur le prothalle, sans qu’il y ait eu fertilisation. Alors que la plantule croit, le prothalle disparait peu à peu, et cette nouvelle fougère produira à son tour des spores diploïdes, perpétuant le cycle apogame.
L’apogamie s’apparente curieusement à une forme de propagation végétative, à la différence près que ce n’est pas une partie de la plante qui est utilisée, mais une seule cellule diploïde.
On estime qu’à travers le monde 5 à 10% d’espèces sont apogames. L’apogamie est plus fréquemment rencontrée dans certains genres que dans d’autres, comme par exemple les Asplenium , Cheilanthes , Cyrtomium , Pteris et Pellaea . A l’inverse, elle est absente chez les Thelypteris , Blechnum , Cyathea et Dicksonia .
L’apogamie survient plus souvent chez les fougères qui se développent dans des habitats secs, comme les déserts et les parois rocheuses exposées au soleil; Dans ce genre d’environnement, l’apogamie offre 2 avantages. Tout d’abord, il n’y a pas besoin d’eau pour la reproduction parce qu’il n’y a pas de fertilisation de l’oosphère par les anthérozoïdes, ces derniers ayant besoin d’eau pour nager vers l’ovule. Ensuite les prothalles des fougères apogames arrivent plus vite à maturité que ceux des fougères se reproduisant sexuellement, ce qui les met à l’abri d’une éventuelle déshydratation au cas où la sécheresse surviendrait. Bien que l’apogamie soit fréquente chez les fougères des habitats secs, il existe aussi des espèces apogames dans les forêts humides, comme par exemple le Dryopteris cycadina . On ne sait pas quel avantage présente l’apogamie dans ce type d’habitat.
Une autre particularité des fougères apogames est que 75% d’entre elles possèdent 3 lots ou plus de chromosomes dans leurs cellules, au lieu de 2 lots, comme c’est généralement le cas. Ce phénomène est connu sous le nom de polyploïdie. La plupart des espèces polyploïdes comptent 3 lots de chromosomes, et de ce fait, sont triploïdes. C’est le cas du Pteris cretica var. albolineata, du Cyrtomium fortunei et du Dryopteris atrata . C’est parce que ces fougères sont triploïdes qu’elles doivent nécessairement être apogames. Pour des raisons génétiques, elles ne peuvent se reproduire sexuellement. La cause en est la façon dont les chromosomes se comportent durant la méiose. Au cours de la méiose, seuls 2 lots de chromosomes sur les 3 vont pouvoir s’apparier, le 3ème restant seul. Les chromosomes des 2 lots appariés se séparent ensuite et migrent vers les cellules filles, chacune recevant 1 chromosome de chaque type. Mais les chromosomes du lot non apparié sont distribués de façon inégale aux cellules filles, et de cette répartition inégale résulte la production de spores abortives qui ne pourront germer.
L’apogamie apparait donc comme la solution à ce problème puisqu’elle saute l’étape de la méiose qui implique que les chromosomes soient assortis par 2. Par conséquent, les fougères triploïdes qui se reproduisent par apogamie peuvent produire des spores viables.
En général, les fougères se reproduisant par apogamie ont une aire de distribution plus vaste que celle de leurs congénères se reproduisant sexuellement. Cela s’explique par la venue à maturité plus rapide du prothalle et par l’absence de fécondation.
Curieusement certaines espèces peuvent posséder plusieurs races, diploïdes et polyploïdes, que rien ne peut différencier à l’oeil nu. Mais bien souvent la race diploïde possède une distribution plus restreinte.
Loin de constituer une anomalie, l’apogamie est plus fréquente qu’on le pense généralement. Elle apparait comme une stratégie intelligente qui permet à certaines espèces de se reproduire dans des conditions difficiles et d’étendre leur aire de distribution.
Sources : article de Jennifer IDE, paru dans The Pteridologist volume 1 Part 5
Robbin C.MORAN A Natural History of Ferns